Mozambique 3 - Escales
Premier contact
Sur son paddle, Shirley rejoint le catamaran à l’arrêt depuis quelques minutes à peine. Le capitaine a choisi de mouiller devant le lodge Kawalala, à Nacala. Shirley souhaite la bienvenue, l’occasion pour le mousse de bavarder un moment. Son mari Mike contactera un agent de l’Inamar (Affaires Maritimes Mozambicaines). Abdul s’est révélé un agent de confiance qui accompagne les catamarans dans leurs démarches, à Nacala, à Ilha de Mozambique, à Moma, à Beira.
Pourtant les échos n’étaient pas encourageants. Les équipages devaient, au dire des rumeurs de ponton, s’attendre à un accueil médiocre, voire même des tentatives de racket. Le Mozambique est un pays qui s’ouvre très progressivement aux plaisanciers. Le sud, oui, nous dit-on, les Sud-Africains font escale à Bazaruto, mais le nord, non, franchement méfiez-vous, attendez-vous à des ennuis.
Depuis sa première escale à Nacala, Moetera a parcouru, cinq semaines durant, 650 milles, a visité des villages où probablement un enfant de 12 ans n’a jamais vu un étranger et certainement jamais vu un voilier blanc cent fois plus grand que la pirogue de son tonton.
Bilan : les mozambicains sont chaleureux et accueillants.
Oui, parfois, des « officiels » ou du moins des hommes et des femmes qui s’en réclament, ont tenté d’arrondir leur maigre fin de mois, cherchant à profiter d’une opportunité rare.
Une certitude, au Mozambique, on ne compte pas son temps, celui passé en négociations.
Les baies sont animées
Au pied des dunes, à l’abri des brisants, dans une clairière de mangrove, se nichent les villages de pêcheurs. Des dizaines de pirogues, à voiles, à pagaie, monoxyles ou en équipage, se croisent.
Sur l’eau, on s’interpelle d’une pirogue à l’autre, on bavarde, on aide le voisin à relever le filet, à dénouer une ligne emmêlée. Les échos des conversations envahissent la baie. Au Mozambique, on porte haut la voix, le chuchotement n'est pas convenable.
Les hommes partent le matin en mer et reviennent à la bascule de la brise, à la mi-journée. D’autres ont lancé leur ligne dans l’eau calme d’un bras de l’estuaire.
Sur les bancs de sable, des groupes d’hommes et d’enfants pratiquent la pêche à la senne. Une pirogue tire le filet dans l’eau, dessinant un large arc, les extrémités sont tendues sur le sable. Sur le banc, les enfants profitent du désœuvrement temporaire pour jouer, ils attendent l’ordre des ainés qui les appelleront pour rabattre le filet. Alors, les jeunes, garçons et filles, se rangent en file indienne, la ralingue en main, ils hissent le filet sur la plage.
Un peu plus loin vers le village, l’eau jusqu’à la taille, marchant dans la vasière, le seau au bras et surveillant d’un œil leurs plus jeunes enfants restés sur le sable, les femmes ramassent les crabes à marée basse, un pélican à bec jaune les ignore, picorant dans la vase.
La pêche traditionnelle est une affaire collective. Au Mozambique, les pêcheurs s’organisent en comités communautaires de pêche. Mais la pêche est maigre, elle ne nourrit plus assez confie un pêcheur au capitaine. Les villageois sont dans l’urgence de se nourrir. L’épuisement de la ressource halieutique est un phénomène qu’ils subissent tout en le provoquant. Phénomène connu ailleurs.
Flashs rencontres
« Bom Dia! », bas tendu, pouce levé, sourire.
Deux grands voiliers blancs mouillent devant le banc de sable qui se découvre à marée basse. C’est un évènement venu perturber la vie quotidienne de la baie. Les pêcheurs ne résistent pas à l’envie de s’approcher. Un coup de gouvernail à tribord, voile abattue, la pirogue ralentit à l’approche du catamaran, elle le longe, et hop, l’arrière à peine dépassé, nouveau coup de gouvernail pour boucler le demi-cercle autour du voilier. Les têtes sont tournées vers le voilier, les regards plongent dans le cockpit.
Ah si seulement ils pouvaient se dévisser la tête, prolonger, le temps d'infiltrer du regard l'intérieur du voilier.
Parfois l’un d’entre eux tend une prise. Poisson ? Un autre porte devant sa bouche son pouce, il a soif. Le capitaine lui tend une bouteille d’eau ou de soda.
Une fois seulement, les équipages ne se sentent pas les bienvenus.
Baie de Conducia, les catamarans ont doublé une pointe de sable au fond de l’estuaire ; ils jettent l’ancre dans une petite baie très protégée. Un trou à cyclone déclare le capitaine. Une foule s’est rassemblée sur la pointe au passage des voiliers.
Immédiatement, les hommes en pirogue se dirigent vers les catamarans, viennent virer au plus proche, jusqu’à les frôler. C’est le seul endroit où le capitaine doit faire preuve de fermeté pour éloigner les pirogues et rendre à la raison les hommes auto-déclarés officiels qui cherchent à monter sur le bateau dans l’espoir de percevoir une petite « taxe ». « Ils sont un peu tendus avec la guerre dans le nord » avait expliqué un français installé à Ilha de Mozambique.
Du cockpit, le mousse entend les cris des enfants, les clameurs d’une cour d’école, sans école.
Les enfants interpellent le grand voilier blanc. La réponse du mousse provoque des exclamations de joie. Les ainés portent des seaux, la petite troupe chasse le crabe. La veille, l’équipage avait été à leur rencontre, distribution de bonbons, de cahiers et de crayons de couleurs, quelques photos instantanées et offertes avaient fait de cette journée une fête.
Moma
Oh, vous allez jusqu’au Brésil ? En avion ? Non, Olga, avec nos bateaux.Aaah, Brésil, alors il faudra apprendre le portugais ! Elle a raison Olga, la policière de Moma avec qui le mousse papote depuis un moment.
Olga, petite femme aux jolies formes dans son uniforme, au visage souriant mais au regard déterminé, se tient assise sur l’une des deux chaises en plastique du poste de la police maritime de Moma.
Poste de police maritime. Une simple halle couverte posée sur la grève. Deux épaves, un chalutier et une vedette, gisent sur l’estran, uniques embarcations motorisées de la baie jetées là par un cyclone. Un manguier, les pieds dans le sable offre un peu d’ombre. Parce que le soleil brûle à Moma, et le sable brûle les plantes de pieds.
Dans la halle, sur un côté, deux pièces fermées, l’une fait office de bureau, sombre, la minuscule ampoule ne suffit pas à éclairer la table. Le capitaine a compris que celle de gauche est l’armurerie, laissée ouverte, d’ailleurs, quand les trois policiers, à l’heure de midi, ont déserté les lieux. Une planche en guise de comptoir. Deux chaises en plastique, la troisième est déglinguée, Olga l’a remisée dans un coin, faire propre pour accueillir les mzungelos.
Papoter… quelques mots, des regards, et l’usage de la langue internationale des gestes, fort bien pratiquée par le mousse.
Olga, trois enfants, de Moma, fière de son job et de son uniforme.
Son supérieur Fernando, parle l’anglais. Et Fernando est bavard, pour une fois qu’il a l’opportunité de parler en anglais avec des étrangers. Fernando est de Nampula, la capitale régionale, à 200 kilomètres de piste. Il fait le trajet. Sa famille est restée à Nampula, pour l’école des enfants, pour sa femme, parce que Moma, c’est un petit bourg paumé au bout d’une piste de sable.
Moma, c’est le village mexicain dans les Sept Mercenaires, on s’attend à croiser Steeve Mac Queen et Charles Bronson au détour d’un croisement. Plan quadrangulaire, héritage de la colonisation portugaise, bâtisses à toit plat, une sur deux décrépie ou en ruine, encore le cyclone, le meurtrier de 2019 ou un plus récent. Un large boulevard traverse le bourg. Le sable envahit les artères. C’est moche Moma et pourtant l’équipage s’y sent bien. Les habitants de Moma font le job.
Le mousse prend la place à l’arrière, le capitaine s’assoit devant, entre le mousse et le chauffeur. Le moto-taxi démarre doucement, les roues s’enfoncent sous la charge dans le sable, le poids de la charge, ne pas déraper. Pour une fois qu’il a des clients. Et des bons ! Parce que depuis que les mzungelos sont arrivés, le prix de la course a doublé. Une opportunité en or, imaginez : 50 mtc (0,7 cts) pour une course du poste de police au marché.
Le panier au bras, le mousse disparait dans une étroite allée encombrée de primeurs. Il faut baisser la tête, les toiles de sacs de riz et de farine, assemblées les unes aux autres, font office d’ombrière. Les étals sont faits d’une planche, on trouve les ignames sur une natte à terre. Les vendeurs ont préparé des pyramides de cinq ou six tomates ou poivrons. Le prix est à la pyramide. Celui de l’œuf à l’unité. Pour faire le marché, penser à la monnaie, la petite, celle qui ne se dit même pas en euros.
Retour en moto-taxi au poste de police. Il faut attendre Fernando, le chef. On attend toujours au Mozambique. On ne sait plus très bien pourquoi. Mais on attend.
En face du poste, capitaine et mousse s’installent dans une échoppe. Menu simple et copieux : poulet, riz et matapa (feuilles de manioc, lait de coco, cacahuètes, ail, le tout pilé), le lendemain, poisson grillé, riz et matapa. La mère a installé son restaurant dans une case. Quatre tables et les bancs fabriqués de planches, cachés du soleil brûlant par de vieilles capulanas défraichies, ces grandes étoffes qui servent de jupes et de fichus aux femmes, de nattes au marché ou encore de rideaux dans la case. Dans la bassine, en guise d’évier, le cadet y épluche les crevettes. Le foyer est installé au sol de l’arrière cuisine où cuit le riz dans un gros chaudron. La fille aînée présente aux étrangers une bassine d’eau et un savon. On mange avec les doigts. Mais pour les mzungelos, on leur a trouvé des fourchettes et des cuillers.
Avec trois fois rien, sans eau courante, sans électricité, sans gaz, cette femme a réussi à faire de son restaurant un lieu fréquenté. Il fait aussi Take-Away, des clients, le personnel des agences internationales, garent leurs pick-up devant la case le temps de récupérer leurs barquettes. Pour 7 euros (à deux), on se régale, on repart repu.
Fernando revient. Il va rendre service aux capitaines.
Le capitaine avait tenté de retirer de l’argent. Moma dispose de deux agences bancaires, les seuls bâtiments du bourg aux couleurs clinquantes, aux vitrines tapissées de photos d’hommes et de femmes souriant de béatitude : la banque détient la clef du paradis de la consommation.
La charmante hôtesse a expliqué au capitaine que, n’ayant pas de compte dans ladite banque, le retrait lui est interdit. Fernando s’est alors proposé d’intermédiaire. Le lendemain, les capitaines quittèrent les catamarans à l’heure du café matinal et ne rentrèrent qu’à celle de l’apéritif du soir ! Ils passèrent la journée à attendre Fernando, parti remplir sa mission à la banque.
Mais que peut bien faire un policier dans une banque pendant … 8 heures ! Le mystère reste entier, mais le service proposé fut rendu.
Le jour suivant, la tempête montée plus au nord, le calme revenu, les catamarans appareillent.






.png)
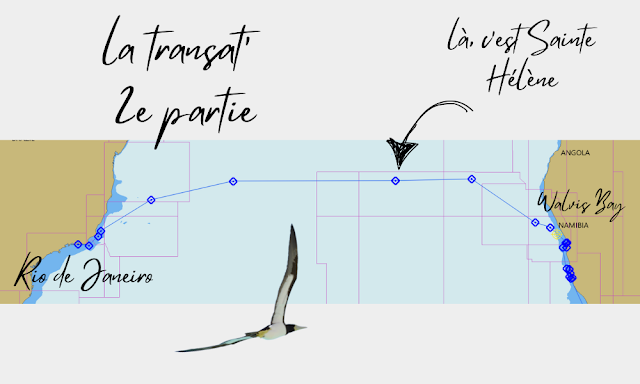


Commentaires
Enregistrer un commentaire